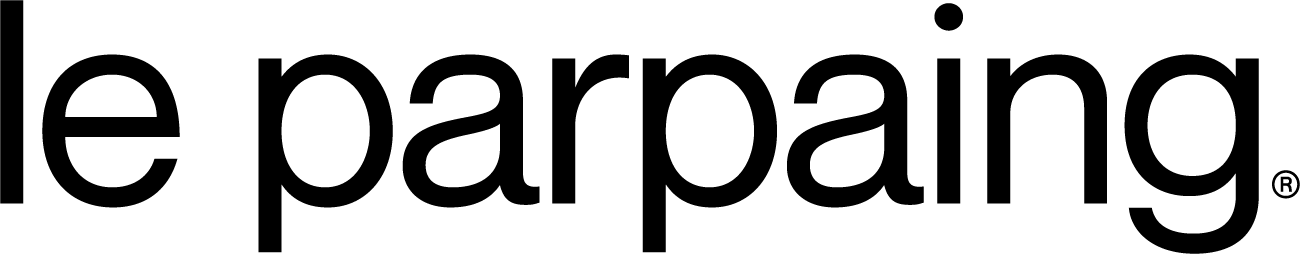Formation à la dépose sélective - résidence Jean Monnet
Extrait de How to construire en réemploi nº3 - Savoir & Faire
A - CONTEXTE
Les métiers du BTP s’inscrivent aujourd’hui dans une problématique nationale urgente et massive liée à l’impact environnemental des déchets, et tout particulièrement des déchets issus du champ de la construction. En parallèle de cette situation, qui semble difficilement tenable à long terme, s’ajoute la question de la raréfaction des ressources, le secteur du BTP en étant un grand consommateur par la voie de l’extractivisme (métaux, industrie pétrochimique, ressources minérales). Le réemploi réunit ces deux sujets en un vaste projet sociétal permettant de réduire les déchets et proposant une alternative d’approvisionnement pour les projets de construction ou de réhabilitation.L’acculturation des acteur·rice·s de la construction au réemploi et le crédit que celui-ci obtient avec le temps s’accompagne de la résolution de différentes problématiques d’ordre organisationnel, technique, économique, assurantiel ou juridique. Les lignes bougent à plusieurs niveaux et cela n’échappe pas aux métiers de la construction et de la déconstruction.
Identifiés comme “émergentes” ou “en forte évolution”, les pratiques de terrain liées au réemploi sont depuis peu caractérisées en ces termes par France Compétence. Ces nouveaux métiers d’avenir, parmi lesquels : diagnostiqueur.euse, valoriste et ouvrier.re. de la déconstruction sélective, sont les piliers en puissance d’une filière en plein essor. Ce dernier nous intéresse tout particulièrement car il marque un retour vers les pratiques oubliées de dépose soigneuse. Systématiquement pratiquée par le passé, la déconstruction a disparu au profit d’interventions mécanisées et destructives, ayant provoqué par là-même un changement d’appellation qui retient le terme de “démolition”.
Notre ambition est d’accompagner le retour de ces pratiques en dédiant une formation au métier d’ouvrier.e. de la déconstruction sélective. Le démarche vise à terme l’apparition d’un nouveau référentiel au répertoire des métiers du BTP. Cette nouvelle qualification, pleinement inscrite dans son époque, défend l’idée d’une pratique vertueuse qui recentre son fonctionnement sur les capacités intellectuelles et manuelles des individus, redonnant ainsi sa noblesse à l’artisanat de dépose sélective. Zerm a ainsi écrit et encadré une nouvelle formation qui s’est tenue, sous forme de chantier école, dans l’ancienne Résidence Jean Monnet à Roubaix (59) mise à disposition par l’Office Public de l’Habitat du Nord. La formation s’est adressée à un public en insertion par le travail issu du groupe Ardeco (Urban Renov).
B - ÉLÉMENTS DÉPOSÉS
➔ 40 blocs de poignée de porte complet pour une porte de 40 mm d’épaisseur, entraxe de fixation : 195 mm
➔ 40 blocs de poignée de porte avec verrou complet pour porte de 40 mm d’épaisseur, entraxe de fixation : 195 mm
➔ 44 miroirs carrés, avec des petits défauts sur le tain en bordure
➔ 2 miroirs rectangulaires, avec petits défauts sur le tain en bordure
➔ 296 boutons de porte de placard blancs en polypropylène et à visser
➔ 6 tringles coudées pour suspension de rideau de douche, avec distance modulable
➔ 23 chaises pliantes en bois de hêtre, modèle des années 1970
➔ 40 chaises de salle à manger en hêtre massif, style André Sornay et année 1980.
➔ 9 chaises de réfectoire avec pieds métalliques ( en rupture de stock )
➔ 41 lavabos avec porte-serviettes chromés, modèle Sapho et de marque PORCHER
➔ 51 abat-jours en acier thermolaqué de couleur bleu menthe ( en rupture de stock )
➔ 15 appliques murales de salle de bain et sans prise
➔ 5 blocs de poignée de porte incomplet, pour porte de 40 mm d’épaisseur, entraxe de fixation : 195 mm
➔ 28 appliques de salle de bain
C - OUVRIER.E DE LA DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE
Bien que dérivé des pratiques de démolition actuelles, le métier d’ouvrier.e de la déconstruction sélective emprunte davantage ses gestes et ses protocoles aux savoir-faire des différent.e.s artisan.e.s de la construction. Il est d’ailleurs très commun qu’un travail d’électricité ou de plomberie, dans un contexte de réhabilitation, commence par la dépose soignée d’appareils existants par le corps d’état concerné. A cela s’ajoute l’idée que tout geste de construction constitue un leg pour qui dépose ensuite. Il existe de fait une responsabilité de l’artisan.e dans le choix des moyens de fixation, d’assemblage et de construction, au regard du vieillissement d’un ouvrage, de son évolution ou de son futur démantèlement. Pour ces différentes raisons, la formation entend définir les contours de ce nouveau titre par emprunts aux différentes pratiques de construction.
La formation s’attarde ainsi sur les gestes et les pratiques à adopter pour anticiper la future dépose des éléments et préserver leur intégrité matérielle au démontage. Le chantier école évite la reconstitution d’un ouvrage et met directement l’apprenti.e en prise avec le réel, dans tout ce qu’il a de complexe : l’altération des systèmes de fixation, le guingois d’une paroi, l’anarchie des réseaux, etc. Cette composante permet d’insister sur la capacité d’adaptation et l’ingéniosité nécessaires à la pratique du réemploi, et plus largement à celle de la réhabilitation, qu’il s’agisse de construire ou de déconstruire. Dans le cadre de cette démarche, le chantier école est d’ailleurs autant un cas pratique pour l’apprenti.e que pour le.a formateur.ice. Cette initiative permet d’interroger la pertinence et l’étendue d’un contenu pédagogique donné et d’affiner peu à peu la trame et le parcours d’apprentissage des prochain.e.s ouvrier.e.s de la déconstruction sélective.
S’adressant à un large panel de ressources, ce “futur” métier est transversal aux divers artisanats de la construction. Les guillemets sont ici nécessaires, quand on connaît l’ancienneté de la pratique et ses premières manifestations sous l’appellation de “spolia”. La Résidence Jean Monnet a cela d’intéressant, qu’elle recense justement des ressources très variées : allant du second œuvre aux équipements sanitaires, en passant par le mobilier et les quincailleries techniques. La diversité des gestes et protocoles de dépose est ainsi étendue et représentative d’un immeuble de logement. Cette typologie d’édifice est complexe car elle nécessite parfois une intervention en milieu occupé (c’est partiellement le cas ici), mais aussi car elle implique un important travail d’appréhension des réseaux et leur consignation. Cette approche, cellule par cellule (bien que similaire les unes des autres), rend fastidieux les efforts de dépose qui se déploient dans des petits espaces et se confrontent à des degrés d’usure variés. A la différence de bâtiments tertiaires ou industriels pour lesquels une plus grande rationalisation des process est possible; le contexte du logement implique une organisation de chantier très élaborée qui en fait un bon sujet d’école.
D - PERSPECTIVES PÉDAGOGIQUES
Les retours d’expérience terrain et leur confrontation, donnent à voir les possibles écueils, points de vigilance ou, a contrario, les synergies à cultiver entre corps d’état. Le travail d’écriture pédagogique se fait ainsi à l’appui du terrain et évite par là-même la production d’un contenu hors-sol. Car le métier d’ouvrier.e. de la déconstruction sélective est particulièrement varié et complexe, le projet ne peut s’abstraire des enseignements du réel. Il doit d’ailleurs capitaliser dessus pour offrir ensuite un parcours éducatif qui navigue habilement entre généralités et spécificités, grandes familles d’intervention et cas particuliers, gestes du quotidien et prises d’initiatives. Pour aller au bout de la démarche, Zerm prévoit de suivre le parcours d’officialisation (sessions complémentaires et enquêtes) de ce nouveau titre professionnel d’ouvrier.e. de la déconstruction sélective jusqu’à son aboutissement.
Ce projet ambitieux vise l’apparition d’un nouveau métier au sein de la filière BTP et propose de définir, étape par étape, la formation qui accompagne son émergence et permet la démocratisation de sa pratique. Notre parti-pris est celui d’une démarche ascendante. Pour ainsi dire, le projet table sur un partenariat resserré autour de structures locales et opérationnelles. Celles-ci le sont dans des champs complémentaires allant de l’apprentissage à l’insertion, en passant par des pratiques professionnelles établies ou des démarches expérimentales. Le caractère “ascendant” du projet valorise une méthode de travail qui s’attache au terrain et inclut à sa réflexion le corps enseignant autant que le corps enseigné, les métiers de pose autant que celui de dépose.
Notre démarche cultive ainsi l’idée qu’une approche empirique donne de la pertinence à la pédagogie, et ce tout particulièrement lorsqu’il est question d’une pratique de déconstruction. Le réemploi est issu d’initiatives militantes et a pour fondement l’idée de métiers plus vertueux. En ce sens, il apparaît naturel qu’un métier innovant par sa transversalité soit l’objet d’une construction pédagogique collective. Par extension, le métier d’ouvrier.e de la dépose sélective, dont le savoir-faire traverse tous les corps d’état, s’inscrit dans la tradition ascendante de la filière réemploi, en cela qu’il s’oppose à la division du travail. Ce phénomène, de plus en plus répandu dans le BTP, est la conséquence d’une bascule progressive du bâtiment vers un nouvel objet de spéculation. Une méthode ascendante est par définition au service des futurs praticien.ne.s du métier. Elle permet une meilleure compréhension des enjeux et une définition plus fine des savoir-faire à transmettre.
Images