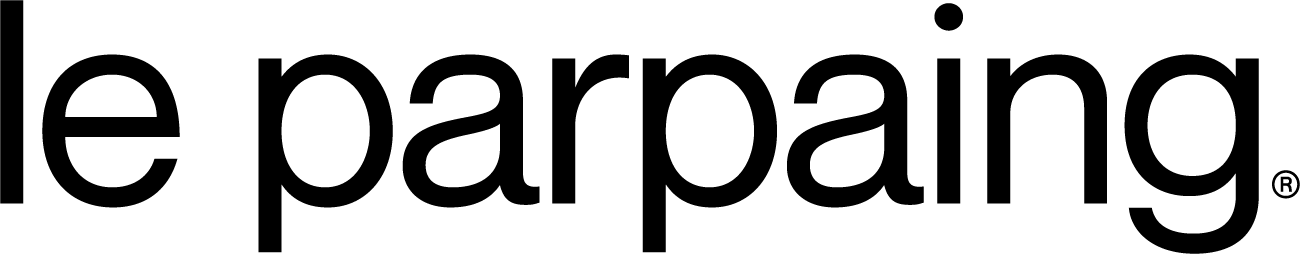Atelier 2024 - La Loco
RÉEMPLOI ET CONTRAINTES ASSURANTIELLES
Afin de rassurer et d’encourager les structures engagées dans la construction vers plus de réemploi, de nombreux obstacles relatifs aux garanties, normes ou certifications doivent être franchis. La massification des démarches a besoin de s’appuyer sur la confiance des professionnels et l’ouverture progressive de l’assurabilité en lien avec la prescription et la mise en œuvre d’éléments de réemploi.
Notons qu’en amont des démarches administratives de projet, de nombreux écueils liés à la captation des gisements peuvent être évités, en particulier celui relatif au statut de déchet. Si la directive européenne relative aux déchets utilise le mot anglais “reuse” pour parler de réemploi, la traduction en droit français a donné lieu à deux termes distincts : réutilisation et réemploi. La distinction tient dans le fait qu’un élément réemployé n’est pas passé par le statut déchet, ce qui est le cas pour un élément réutilisé. Cette première difficulté peut être contournée par le concours d’un opérateur ayant la faculté de distinguer les potentiels de réemploi et effectuant un tri en sortie de chantier.
Les responsables des plateformes de réemploi identifient la question du manque d’assurabilité comme la principale raison de la défiance des entreprises, notamment vis-à-vis de la garantie décennale. La difficulté réside dans le besoin d’assurer les procédés autant que les produits mis en œuvre au sein d’un projet de construction. Le système assurantiel apprécie et supporte les risques au regard d’une distinction faite entre techniques “courantes” et “non courantes”. C’est précisément sur la base de cet arbitrage qu’une entreprise peut être assurée et exercer sa garantie décennale. Cette famille réunit l’ensemble des pratiques de construction connues auxquelles peuvent se rattacher de nombreux retours d’expériences qui attestent de leur fiabilité.
À cet égard, les contrats d’assurances intègrent à leur conditions générales ces techniques courantes. La plupart d’entre elles font référence à des objectifs de moyens plutôt que de résultats en s’appuyant sur des normes “produit”. De fait, la mise en œuvre qui suit la réglementation, mais qui n’a pas recours aux produits normés qui y sont précisés, sera jugée comme non-conforme au regard de cette réglementation. Or, l’un des points communs aux matériaux de réemploi est le fait qu’ils ne peuvent justifier un procédé industriel de production contrôlé, et par conséquent ne peuvent être couverts par une norme. Pour ainsi dire, le non-respect des règles d’exécution courantes met fortement en péril l’assurabilité de l’entreprise, dont la pratique bascule alors dans le registre “non courant”.
La technique non courante s’adresse aux mises en œuvre particulières, pas ou peu expérimentées. De fait, le projet et ses parti-prenantes s’exposent à un risque de sinistre plus important, en cas d’échec d’une solution face aux sollicitations qu’elle reçoit. Cet aléa, si tant est qu’on puisse en percevoir le contour, n’est pas un obstacle définitif à l’assurabilité d’une technique. L’assurance a besoin d’informations relatives à l’élément de réemploi pour mesurer l’aléa qu’il embarque dans le projet. Fiche technique, plaque signalétique, DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), sont autant de pièces administratives qui permettent d’identifier l’élément en question. À cela s’ajoutent toutes les preuves de traçabilité pouvant être fournies alors que l’élément transite, de sa première à sa prochaine destination. On recense pour cela : les modalités de déposes retenues, le conditionnement et les moyens de transports choisis, les conditions de stockage, etc. La compilation de ces informations évite une rupture de traçabilité et permet de déterminer l’aptitude au réemploi d’un élément donné.
Alors que la filière progresse à mesure d’expérimentations, dont certaines font jurisprudence et cas d’école, il est important de noter que l’assurabilité du réemploi est possible mais entraîne une plus grande ingénierie de projet et d’éventuels surcoûts. Ceux-ci peuvent être anticipés par une meilleure coordination des Maîtrises d’Ouvrage, métiers de prescription, organes de contrôle et compagnie d’assurance, par l’intermédiaire d’un Bureau d’Étude Réemploi. Par ailleurs, les fournisseur.euse.s de réemploi commencent peu à peu à fournir des garanties à la vente. Qu’il s’agisse de garanties type “Produit” (délivrées par des plateformes dont les processus de retravail sont micro-industriels) ou de démarches de contrôle spécifiques aux ouvrages conçus, la filière évolue en ce sens. Ceci a pour effet de bâtir peu à peu un climat de confiance, qui se nourrit lui-même des retours d’expérience de plus en plus nombreux sur le sujet. Les limites que rencontre encore la filière sont d’ordre économique notamment, étant donné le peu de crédibilité accordé aux contrôles de performance indépendants. Les projets de réemploi souffrent ainsi de démarches de conformité calquées sur l’économie du neuf dont la trame et les exigences sont parfois éloignées de la réalité matérielle qu’elles observent.
MARQUAGE CE
Le Parpaing a récemment abordé le sujet du marquage CE, sous l’impulsion d’une commande importante de luminaires passée par l’Atelier 204. Les équipements électriques sont de bon candidats au réemploi car leur valeur marchande permet d’absorber plus facilement des démarches annexes relevant de l’assurabilité. Ils embarquent néanmoins des risques importants liés à la sécurité des personnes (incendie électrique notamment) et posent ainsi d’importantes questions juridiques.
Initialement installés dans la première extension de l’Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de Lille, conçue par Olivier Bonte et Walter Chiani en 1999, ces luminaires de marque Zumtobel (modèle RTX 2C) ont été déposé soigneusement à l’occasion de la rénovation de ce même bâtiment. Pris en charge par Le Parpaing, ils ont fait l’objet d’un retravail de fond impliquant la modification de leurs systèmes d’allumage et de fixation. Touchés par l’obsolescence normative en raison de leur fonctionnement par ballast et tube fluorescents, ces appareils ont été convertis en LED (voir How to construire en réemploi n°1).
Etant donnée la modification du produit, les opérations de retravail touchant à l’appareil et allant au-delà du simple nettoyage rendent caduc le marquage CE initial du luminaire, attestant de sa conformité en sortie d’usine. À la demande du bureau de contrôle impliqué dans le projet, Le Parpaing a porté une démarche complète de mise en conformité du produit. Un nouveau marquage CE a ainsi été réalisé à l’appui du LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques). La démarche consiste à spécifier avec précision la natures des interventions et le détail des composants utilisés pour permettre les modifications souhaitées. À cela s’ajoute un important travail de recherche qui renseinge le parcours du produit et reconstitue sa traçabilité complète.
Plusieurs échantillons envoyés en laboratoire subissent alors une batterie de tests liés aux modifications reçues. L’objet de l’évaluation porte sur l’analyse de construction et la réalisation de l’essai d’endurance. Sont ainsi examinés les systèmes d’accroche par filins, l’étanchéité des réseaux électriques et leur résistance. Ces tests, parfois destructifs, permettent de garantir la conformité des modifications apportées aux appareils au regard de la norme (EN IEC 60598-2-1:2021) et donnent lieu à la rédaction d’un rapport d’essai. Celui-ci atteste du bon fonctionnement des luminaires au regard des exigences portées par la norme. Il est transmis au bureau de contrôle et à la compagnie d’assurance et contribue à la réduction des aléas embarqués dans la mise en œuvre de luminaires de réemploi. Il permet ainsi d’ouvrir l’assurabilité d’un projet intégrant la prescription d’éléments de réemploi et limite considérablement la prise de risque occasionnée par ce type de démarche.
FOURNITURE ET POSE
Le projet de la Loco, porté par l’Atelier 204, est la construction d’un tiers-lieux réunissant des activités de travail et de commerce. Située sous l’emprise de la halle F8 sur le site de l’ancienne usine Fives Cail Babcock (Lille), la Loco s’inscrit dans un vaste projet de reconversion urbaine qui voit peu à peu émerger un écoquartier métropolitain en lieu et place de la friche. Le projet a pour idée fondatrice que la démolition n’est plus un préalable systématique à une intervention architecturale. Il cultive ainsi l’idée d’une réhabilitation attentive à l’existant qui démontre son caractère écologique par la préservation des infrastructures en place et le recours au réemploi d’éléments du second œuvre pour son aménagement.
Images